Mon Club des Cinq, no. 1 : José van Dam
Ce que j’appelle mon Club des Cinq est un groupe de chanteurs lyriques (trois hommes et deux femmes) pour lequels mon admiration est sans limite. Malgré quelques associations, jamais ils n’ont chanté tous ensembles. J’ai donc voulu les réunir symboliquement avec cette courte série d’articles, honorant leurs individualtiés et leurs approches de l’opéra. Le but est aussi d’avancer certaines caractéristiques communes qui, selon moi, représentent les éléments indispensables qui distinguent un bon chanteur d’un grand artiste. Pour accomplir cette tâche, j’ai choisi d’employer trois vidéos pour illustrer au mieux un maximum de concepts. Chaque article de la série comprendra : un morceau composé par Mozart, objet de comparaison entre les différentes voix appliquées à un style commun défini; un duo et/ou un ensemble, l’occasion d’apprécier leurs talents harmoniques et leurs facultés d’écoute; enfin, j’utiliserai un aria spécifique qui permettra d’écouter l’ampleur vocale et technique de chaque individu. En prime, je m’arrangerai pour qu’au moins un extrait sur trois soit un enregistrement live.
Sans perdre de temps, commençons cette nouvelle série avec le baryton-basse belge José van Dam (1940). Natif de la capitale, il entre au Conservatoire Royal de Bruxelles à 17 ans et, quelques années plus tard, il fait une entrée tonitruante sur la scène lyrique européenne à l’Opéra de Paris, incarnant Don Basilio, un personnage du fameux “Babier de Séville” composé par Gioacchino Rossini (1792-1868). Il enchaîne alors les succès en France, puis en Allemagne où ses interprétations de Wagner lui valurent très vite une popularité colossale. Il rencontre alors le grand chef d’orchestre Herbert von Karajan (1908-1989) tombé sous la charme de sa voix, commence alors une relation professionnelle et amicale qui durera plusieurs décennies. Une bonne gestion de son instrument et une série de prix conduisent peu à peu le chanteur vers une carrière internationnale de grande envergure. Son talent de comédien le propulse même dans le monde du cinéma pour une apparition unique mais électrisante. En effet, il devient, en 1988, le rôle principal du film “Le Maître de musique” de Gérard Corbiau (1941), nominé pour l’oscar du meilleur film en langue étrangère. Fait baron par le Roi Albert II de Belgique (1934) 10 ans après, il continue à explorer le répertoire, à s’engager pour des productions nouvelles et à favoriser l’éducation artistique dans notre pays. Ce n’est qu’en 2010 que José van Dam met fin à une carrière menée avec grâce et qui aura duré plus de 50 ans, un record, un exemple.
La première vidéo met en scène notre compatriote dans un extrait live assez intense de l’opéra “Les contes d’Hoffman” signé Jacques Offenbach (1819-1880). On peut y appréciez les talents multiples du baryton-basse dans son interprétation jubilatoire, à la fois comique et glaçante, d’un vicieux docteur possédant certains talents cachés. Il se fond avec harmonie dans le mélange des voix qui occupent la scène. Le timbre de van Dam est bien en place, il varie subtilement le parler et le chanter, se greffe parfaitement aux mélodies étranges et aux décors fantastiques avant de révéler toute sa puissance dans un climax survolté.
Des 5 chanteurs lyriques étudiés, la baron belge est probablement le plus grand spécialiste du répertoire mozartien, ayant interprété à maintes occasions différents rôles de ce répertoire; il a même consacré, à plusieurs reprises, des concerts entiers à ce compositeur. Sa voix chaude et duveteuse, sa technique solide couplée d’une articulation irréprochable et son naturel expressif s’additionnent en une combinaison dévastatrice d’efficacité pour ce genre de morceaux. La preuve par l’exemple avec l’aria suivant, issu du fameux “Don Giovanni”, qui se base sur deux mélodies simples variées avec finesse et surtout interprétées avec intelligence.
Enfin, je terminerai ce premier hommage en utilisant un solo qui constitue, pour ce registre de voix, un véritable exercise de style aux nombreuses demandes, tant sur la forme que sur le fond, tiré de la version française d’une oeuvre écrite par Giuseppe Verdi (1813-1901), “Don Carlo”. Ce monologue repose sur une double réflexion du personnage, un roi mélancholique, qui observe sa jeune épouse endormie : il prend conscience que cette femme ne l’aimera jamais et envie son sommeil, lui qui veille sans cesse, insomniaque et fatigué de sa vieillesse, rêvant le pouvoir de Dieu à connaître le coeur des hommes. Une cavalcade de sentiments qui n’ont jamais été délivrés avec tant de passion, de tristesse et de vérité qu’à travers la version ci-dessous. On entend les moindres recoins de cette âme troublée qui exprime ses plaintes au coeur de chaque note. José van Dam est au sommet de son art, brillant, léger, sombre, une ligne de velours se déployant illuminée de science et de tendresse.


 L’homme pensait, dormait, mangeait, respirait la musique à chaque instant, il confia dans plusieurs lettres qu’il aimait à composer dans sa tête au cours de longues promenades en solitaire; à émettre des idées, se les siffloter en marchant d’un bon pas, et de revenir les rédiger en partitions le plus vite possible, perfectionnant en cours d’écriture les détails plus techniques de son travail, le tout pour une efficacité redoutable. Stylistiquement, Mozart est une figure emblématique du courant classique, une atténuation des excès baroques, aux formes musicales simples mais rigoureuses (parfois strictes et ennuyeuses); cependant il serait réducteur d’en faire un archétype de ce genre-là. On note, en effet, une rapide progression dans la prise de liberté formelle chez le jeune musicien, sa maîtrise incomparable des techniques d’écriture ont favorisé, à mon avis, cette caractéristique. C’est à lui qu’on doit la réémergence de certaines complexités baroques qu’il a su modérer par son professionnalisme esthétique, parvenant, de façon subtile et brillante, à mélanger les genres pour créer une musique nouvelle, reconnaissable parmi toutes. Il explorait, dans les moindres détails, les divers moyens d’expression sonore, transformant les messes en chef-d’oeuvres, révolutionnant les morceaux de plaisances comme les divertimenti ou les sérénades, etc, etc. Rien ne pouvait entraver son génie, un raz-de-marée original. Pour condenser, en termes simples, la signature musicale de Mozart, le mot sensualité est le plus fréquemment employé chez les experts et ce à juste titre. L’écouter est une expérience sensorielle complète, les notes sont si minutieuses qu’elles titillent chaque centimètre de peau et gonflent l’esprit de miel, c’est une jouissance de l’âme toute entière. Outre les mélodies, c’est véritablement la perfection, la science avec laquelle sont organisés les instruments, qui donne ce côté divin à l’écoute. Pour ma part, j’ai toujours comparé la méthode mozartienne avec la technique d’écriture de Gustave Flaubert (1821-1880), j’y trouve des talents parallèles et, surtout, une recherche similaire : procurer l’émotion par l’exactitude et le rendu esthétiquement parfait de choses très simples, la beauté du concret, la vérité dite avec le recul mais sublimé par l’art; ils sont, l’un comme l’autres, des orfèvres du normal, ce qui les rend superlatifs à mes yeux. Maintenant que j’ai énoncé tous les faits qui précèdent, place à l’oeuvre d’illustration. Il s’agit du
L’homme pensait, dormait, mangeait, respirait la musique à chaque instant, il confia dans plusieurs lettres qu’il aimait à composer dans sa tête au cours de longues promenades en solitaire; à émettre des idées, se les siffloter en marchant d’un bon pas, et de revenir les rédiger en partitions le plus vite possible, perfectionnant en cours d’écriture les détails plus techniques de son travail, le tout pour une efficacité redoutable. Stylistiquement, Mozart est une figure emblématique du courant classique, une atténuation des excès baroques, aux formes musicales simples mais rigoureuses (parfois strictes et ennuyeuses); cependant il serait réducteur d’en faire un archétype de ce genre-là. On note, en effet, une rapide progression dans la prise de liberté formelle chez le jeune musicien, sa maîtrise incomparable des techniques d’écriture ont favorisé, à mon avis, cette caractéristique. C’est à lui qu’on doit la réémergence de certaines complexités baroques qu’il a su modérer par son professionnalisme esthétique, parvenant, de façon subtile et brillante, à mélanger les genres pour créer une musique nouvelle, reconnaissable parmi toutes. Il explorait, dans les moindres détails, les divers moyens d’expression sonore, transformant les messes en chef-d’oeuvres, révolutionnant les morceaux de plaisances comme les divertimenti ou les sérénades, etc, etc. Rien ne pouvait entraver son génie, un raz-de-marée original. Pour condenser, en termes simples, la signature musicale de Mozart, le mot sensualité est le plus fréquemment employé chez les experts et ce à juste titre. L’écouter est une expérience sensorielle complète, les notes sont si minutieuses qu’elles titillent chaque centimètre de peau et gonflent l’esprit de miel, c’est une jouissance de l’âme toute entière. Outre les mélodies, c’est véritablement la perfection, la science avec laquelle sont organisés les instruments, qui donne ce côté divin à l’écoute. Pour ma part, j’ai toujours comparé la méthode mozartienne avec la technique d’écriture de Gustave Flaubert (1821-1880), j’y trouve des talents parallèles et, surtout, une recherche similaire : procurer l’émotion par l’exactitude et le rendu esthétiquement parfait de choses très simples, la beauté du concret, la vérité dite avec le recul mais sublimé par l’art; ils sont, l’un comme l’autres, des orfèvres du normal, ce qui les rend superlatifs à mes yeux. Maintenant que j’ai énoncé tous les faits qui précèdent, place à l’oeuvre d’illustration. Il s’agit du  L’intrigue, oppose Mozart à son contemporain Antonio Salieri (1750-1825), jaloux du talent immaculé qu’arbore son rival. Au cours de la scène en question, Salieri explique, entre la rage et l’admiration, son ressenti au moment de lire certaines partitions incomplètes du jeune prodige : “
L’intrigue, oppose Mozart à son contemporain Antonio Salieri (1750-1825), jaloux du talent immaculé qu’arbore son rival. Au cours de la scène en question, Salieri explique, entre la rage et l’admiration, son ressenti au moment de lire certaines partitions incomplètes du jeune prodige : “ A la place, je préfère vous raconter comment le compositeur russe Alexander Glazunov (1865-1936) a découvert, sur le tard, cet objet fabuleux. Alors un musicien respecté dans son pays, Glazunov avait entrepris une série de voyages à travers l’Europe dés 1928 pour, enfin, s’installer à Paris. C’est à partir de cette période qu’une série de maladies et autres problèmes physiques écrasèrent véritablement son mode de vie. Impossible, par exemple, de rejoindre la terre natale où, par ailleurs, le régime soviétique exerçait un contrôle toujours plus autoritaire sur la musique et ses praticiens dont les œuvres devaient, à tout prix, rentrer dans un moule nationaliste validé par le Kremlin, faute de quoi l’auteur était sanctionné. Voici donc notre compositeur, terriblement diminué, en fin de vie, mais libre de s’exprimer comme il le souhaite. Et justement, ce concours de circonstances a été crucial pour l’existence même de son “concerto pour saxophone, op. 109″ ! Il faut savoir que l’instrument, à cette période, était soit considéré comme barbare pour ceux qui voyaient d’un mauvais œil l’ascension du jazz, soit labellisé comme un jouet bourgeois réservé aux classes moyennes fortunées et, du coup, désapprouvé par le gouvernement de Staline et sa moustache prolétarienne. Or, Alexander était tombé en admiration pour ce nouveau moyen d’expression sonore, tant et si bien qu’il écrivit un quartet pour saxophones; l’expérience est racontée dans une série de lettres adressées à plusieurs de ses amis auxquels il expliquait cette passion mais aussi son état de santé inquiétant. Le succès du quartet en Europe de l’Ouest et dans les pays nordiques fit naître un enthousiasme brûlant teinté d’opportunisme chez Sigurd Rascher (1907-2001), un saxophoniste danois qui pressa l’exilé soviétique d’un lobbying plutôt agressif, lui commandant une nouvelle incursion dans ce répertoire. De fil en aiguille, Glazunov se mit à composer l’œuvre demandée, un concerto. Impatient d’écouter le résultat, il travaillait de longues heures et acheva son opus en un délai record. Malheureusement pour lui, le destin avait choisi qu’il n’entendrait jamais le morceau terminé; il mourut le 21 mars 1936, quelques jours avant la représentation. Parlons maintenant du compositeur lui-même et de son style. Naturellement doué d’une mémoire auditive phénoménale, Alexander Glazunov peut être considéré comme un artiste paradoxal. D’abord influencé par le style russe qui rejetait l’académisme formel occidental, il s’est progressivement adapté aux canons allemands et français. Ses compositions plus matures montrent un genre mixte très fluide avec une pureté contrapuntique* assez rare pour l’époque et fortement orientée vers de justes harmonies très maîtrisées au sein de l’orchestre. Tous ces éléments se retrouvent dans le concerto que je vous propose. Le saxophone y est uniquement accompagné de cordes. Aucune pause ne distinguant les trois mouvements du travail, il glisse d’un sentiment à l’autre via de subtiles transitions. L’ouverture est un court segments très lisse des cordes qui sont reprises par le soliste.
A la place, je préfère vous raconter comment le compositeur russe Alexander Glazunov (1865-1936) a découvert, sur le tard, cet objet fabuleux. Alors un musicien respecté dans son pays, Glazunov avait entrepris une série de voyages à travers l’Europe dés 1928 pour, enfin, s’installer à Paris. C’est à partir de cette période qu’une série de maladies et autres problèmes physiques écrasèrent véritablement son mode de vie. Impossible, par exemple, de rejoindre la terre natale où, par ailleurs, le régime soviétique exerçait un contrôle toujours plus autoritaire sur la musique et ses praticiens dont les œuvres devaient, à tout prix, rentrer dans un moule nationaliste validé par le Kremlin, faute de quoi l’auteur était sanctionné. Voici donc notre compositeur, terriblement diminué, en fin de vie, mais libre de s’exprimer comme il le souhaite. Et justement, ce concours de circonstances a été crucial pour l’existence même de son “concerto pour saxophone, op. 109″ ! Il faut savoir que l’instrument, à cette période, était soit considéré comme barbare pour ceux qui voyaient d’un mauvais œil l’ascension du jazz, soit labellisé comme un jouet bourgeois réservé aux classes moyennes fortunées et, du coup, désapprouvé par le gouvernement de Staline et sa moustache prolétarienne. Or, Alexander était tombé en admiration pour ce nouveau moyen d’expression sonore, tant et si bien qu’il écrivit un quartet pour saxophones; l’expérience est racontée dans une série de lettres adressées à plusieurs de ses amis auxquels il expliquait cette passion mais aussi son état de santé inquiétant. Le succès du quartet en Europe de l’Ouest et dans les pays nordiques fit naître un enthousiasme brûlant teinté d’opportunisme chez Sigurd Rascher (1907-2001), un saxophoniste danois qui pressa l’exilé soviétique d’un lobbying plutôt agressif, lui commandant une nouvelle incursion dans ce répertoire. De fil en aiguille, Glazunov se mit à composer l’œuvre demandée, un concerto. Impatient d’écouter le résultat, il travaillait de longues heures et acheva son opus en un délai record. Malheureusement pour lui, le destin avait choisi qu’il n’entendrait jamais le morceau terminé; il mourut le 21 mars 1936, quelques jours avant la représentation. Parlons maintenant du compositeur lui-même et de son style. Naturellement doué d’une mémoire auditive phénoménale, Alexander Glazunov peut être considéré comme un artiste paradoxal. D’abord influencé par le style russe qui rejetait l’académisme formel occidental, il s’est progressivement adapté aux canons allemands et français. Ses compositions plus matures montrent un genre mixte très fluide avec une pureté contrapuntique* assez rare pour l’époque et fortement orientée vers de justes harmonies très maîtrisées au sein de l’orchestre. Tous ces éléments se retrouvent dans le concerto que je vous propose. Le saxophone y est uniquement accompagné de cordes. Aucune pause ne distinguant les trois mouvements du travail, il glisse d’un sentiment à l’autre via de subtiles transitions. L’ouverture est un court segments très lisse des cordes qui sont reprises par le soliste. La mélodie est agréablement profonde, exposée de manière professionnelle sans céder pour autant au conformisme ennuyeux. Les notes sont chaudes et montrent toute l’étendue des sons différents que peut produire un saxophone, lui qu’on rattache systématiquement au blues et aux ambiances feutrées. Exit les bars aux lumières froides remplis de fumée, adieu la catégorisation perpétuelle; l’instrument libéré est ici tantôt joyeux, tantôt triste, parfois taquin, parfois solennel; il développe une palette incroyablement vaste d’impressions. En se laissant bercer, les yeux clos, on peut s’égarer dans quelques visions bucoliques, c’est un vagabondage émotionnel perclus de finesse. Charmante, souple, la métamorphose élégante et ciselée illustre bien la recherche de cet artiste qui voulait exprimer son amour de la musique par la précision et la virtuosité formelle, mission accomplie avec ce glorieux plébiscite à savourer sans modération. A plus tard amis lecteurs.
La mélodie est agréablement profonde, exposée de manière professionnelle sans céder pour autant au conformisme ennuyeux. Les notes sont chaudes et montrent toute l’étendue des sons différents que peut produire un saxophone, lui qu’on rattache systématiquement au blues et aux ambiances feutrées. Exit les bars aux lumières froides remplis de fumée, adieu la catégorisation perpétuelle; l’instrument libéré est ici tantôt joyeux, tantôt triste, parfois taquin, parfois solennel; il développe une palette incroyablement vaste d’impressions. En se laissant bercer, les yeux clos, on peut s’égarer dans quelques visions bucoliques, c’est un vagabondage émotionnel perclus de finesse. Charmante, souple, la métamorphose élégante et ciselée illustre bien la recherche de cet artiste qui voulait exprimer son amour de la musique par la précision et la virtuosité formelle, mission accomplie avec ce glorieux plébiscite à savourer sans modération. A plus tard amis lecteurs. Comme le suggère le titre, j’ai voulu commencer sans retenue par un très gros morceau, difficile de faire autrement avec Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) et encore moins quand on écoute son concerto pour piano no. 5, op. 73 “Empereur”, écrit en 1808. Contrairement à ses 4 prédécesseurs, le morceau ne fut pas interprété par l’artiste lui-même qui était, par ailleurs, un pianiste virtuose, pour la simple et bonne raison qu’en 1811, au moment d’inaugurer cette nouvelle production, Beethoven éprouvait déjà plusieurs graves symptomes d’une surdité complète à venir*, ce qui était particulièrement domageable pour une performance réussie. On le sait, ce compositeur est une des figures les plus importantes de l’histoire de la musique. Outre ses qualités techniques et son indéniable talent, il fut la principale transition du classicisme au romantisme dans ce domaine artistique exigeant. Si l’homme s’inscrit, bien sûr, au coeur d’une évolution continue, il occupe malgré tout une place à part, celle d’un véritable pionnier. En effet, une imagination géniale et un désir perpétuel de repousser, toujours plus loin, les frontières du monde musical, ont fait de lui un géant. Au cours de cette période surtout, entre 1803 et 1813, Beethoven affrimait avec chaque nouvel opus, une signature de plus en plus personnelle; ses maîtres mots : innovation, sentiments et variété. Il voulait tant révolutionner l’expression mélodique, tant perfectionner son style, y mettre du ressenti, oser l’experience de sonorités plus intimes à grande échelle, qu’inévitablement ses oeuvres, en plus d’obéir à une inspiration de base, portent la trace indélébile de ces différents aspects. Le concerto présenté ici comporte un grand nombre de nouveautés formelles dont je vous épargnerai la description, ne vous affolez pas; mais il reste pertinent pour vous de le savoir. Le matériel mélodique développé présente une grande étendue, motifs, thèmes, arrangements, variations, de nombreux changement de clefs, le tout formant un bloc compact et dense. Avec éclat, le morceau s’ouvre, pétulant, le piano effectue, d’emblée, une triple glissade soutenue par la stricte cadence de l’orchestre en contrepoids avant que l’exposition thématique du mouvement ne se dégage entre fraîcheur et robustesse. C’est une sorte de chevauchée gracieuse emprunte d’une tendresse admirable; les différents motifs sont installés puis donnent lieu à une exploration sans borne, chaque ensemble mélodique est trituré, changé, sublimé; flottant de l’un à l’autre sans la moindre anicroche, le premier mouvement s’étire ainsi pendant près de 20 minutes (ce qui était très rare à l’époque). Il en ressort un tel brio et, en même temps, une telle facilité, qu’on est véritablement submergé par ces notes opulentes, elles se poursuivent majestueusement vers un final limpide. La magnitude et la puissance héroïque de cette partie offre un contraste prodigieux avec la douceur qui s’ensuit.
Comme le suggère le titre, j’ai voulu commencer sans retenue par un très gros morceau, difficile de faire autrement avec Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) et encore moins quand on écoute son concerto pour piano no. 5, op. 73 “Empereur”, écrit en 1808. Contrairement à ses 4 prédécesseurs, le morceau ne fut pas interprété par l’artiste lui-même qui était, par ailleurs, un pianiste virtuose, pour la simple et bonne raison qu’en 1811, au moment d’inaugurer cette nouvelle production, Beethoven éprouvait déjà plusieurs graves symptomes d’une surdité complète à venir*, ce qui était particulièrement domageable pour une performance réussie. On le sait, ce compositeur est une des figures les plus importantes de l’histoire de la musique. Outre ses qualités techniques et son indéniable talent, il fut la principale transition du classicisme au romantisme dans ce domaine artistique exigeant. Si l’homme s’inscrit, bien sûr, au coeur d’une évolution continue, il occupe malgré tout une place à part, celle d’un véritable pionnier. En effet, une imagination géniale et un désir perpétuel de repousser, toujours plus loin, les frontières du monde musical, ont fait de lui un géant. Au cours de cette période surtout, entre 1803 et 1813, Beethoven affrimait avec chaque nouvel opus, une signature de plus en plus personnelle; ses maîtres mots : innovation, sentiments et variété. Il voulait tant révolutionner l’expression mélodique, tant perfectionner son style, y mettre du ressenti, oser l’experience de sonorités plus intimes à grande échelle, qu’inévitablement ses oeuvres, en plus d’obéir à une inspiration de base, portent la trace indélébile de ces différents aspects. Le concerto présenté ici comporte un grand nombre de nouveautés formelles dont je vous épargnerai la description, ne vous affolez pas; mais il reste pertinent pour vous de le savoir. Le matériel mélodique développé présente une grande étendue, motifs, thèmes, arrangements, variations, de nombreux changement de clefs, le tout formant un bloc compact et dense. Avec éclat, le morceau s’ouvre, pétulant, le piano effectue, d’emblée, une triple glissade soutenue par la stricte cadence de l’orchestre en contrepoids avant que l’exposition thématique du mouvement ne se dégage entre fraîcheur et robustesse. C’est une sorte de chevauchée gracieuse emprunte d’une tendresse admirable; les différents motifs sont installés puis donnent lieu à une exploration sans borne, chaque ensemble mélodique est trituré, changé, sublimé; flottant de l’un à l’autre sans la moindre anicroche, le premier mouvement s’étire ainsi pendant près de 20 minutes (ce qui était très rare à l’époque). Il en ressort un tel brio et, en même temps, une telle facilité, qu’on est véritablement submergé par ces notes opulentes, elles se poursuivent majestueusement vers un final limpide. La magnitude et la puissance héroïque de cette partie offre un contraste prodigieux avec la douceur qui s’ensuit.  En effet, Beethoven enchaîne avec un adagio** qui sonne presque comme une friandise mélancolique, la transition est simple, divine. Je manque cruellement de superlatifs pour effleurer de mes mots la somptuosité attachante de pareilles minutes. Le mariage des instruments évoque la quiétude, une harmonie qui atteint son apogée lorsque tout l’orchestre reproduit une ambiance faite de murmures coulissants. L’oeuvre s’enchaîne, brillament, sans pause, avec le dernier mouvement. L’ingéniosité du compositeur est au zénith, il nous offre une explosion de classe étourdissante. Un court duo entre les timbales et le piano nous embarque enfin vers une conclusion triomphale. Ludwig van Beethoven voulait créer un nouveau dialogue avec la musique, il inventait de nouveaux codes pour ce langage universel avec passion; son zèle et son génie s’imposent dans ce concerto éblouissant, la magie opère et retentit, un accomplissement voué à l’éternel. A plus tard chers lecteurs.
En effet, Beethoven enchaîne avec un adagio** qui sonne presque comme une friandise mélancolique, la transition est simple, divine. Je manque cruellement de superlatifs pour effleurer de mes mots la somptuosité attachante de pareilles minutes. Le mariage des instruments évoque la quiétude, une harmonie qui atteint son apogée lorsque tout l’orchestre reproduit une ambiance faite de murmures coulissants. L’oeuvre s’enchaîne, brillament, sans pause, avec le dernier mouvement. L’ingéniosité du compositeur est au zénith, il nous offre une explosion de classe étourdissante. Un court duo entre les timbales et le piano nous embarque enfin vers une conclusion triomphale. Ludwig van Beethoven voulait créer un nouveau dialogue avec la musique, il inventait de nouveaux codes pour ce langage universel avec passion; son zèle et son génie s’imposent dans ce concerto éblouissant, la magie opère et retentit, un accomplissement voué à l’éternel. A plus tard chers lecteurs. Quels sont mes motifs ? Je me prépare en ce moment à vous livrer une explication tordue mais justifiée; en plus d’être, à présent, devenue capitale afin de ne pas trop passer pour un imbécile. C’est que la psychanalyse a un rapport plus ou moins direct avec le morceau traité dans cet article. Il s’agit de la Symphonie no. 4, op. 63 écrite par le formidable compositeur finlandais Jean Sibelius (1865-1957) au cours de l’année 1911; ce morceau est souvent considéré comme le plus énigmatique jamais écrit par l’artiste. A cette époque, après un démarrage tonitruant et controversé sur la scène des maladies psychologiques, les concepts du docteur Freud connaissaient une immense popularité, mais plus encore que la discipline proprement dite, c’est toute l’ambiance idéologique de cette période qui jouèrent un rôle déterminant pour l’écriture de cette œuvre singulière. Dans l’ombre du romantisme, cette nouvelle approche individualiste de l’être, prologue des excès que nous connaissons actuellement, allait, en effet, se matérialiser dans la société par une nécessité active d’expression de soi, par un besoin grandissant d’introspection. En art, c’est le courant expressionniste, dans lequel s’inscrit l’objet de notre étude, qui représente au mieux cette tendance. Dans ce cas de figure, commenter le morceau doit s’établir sur une recherche de ce que l’auteur a essayé de dire; il faut le comprendre et donc se poser la question suivante : quels sentiments a-t-il voulu transmettre par l’utilisation de son propre dialecte musical ? Pour y répondre, je me suis plongé dans le chaos indescriptible qui rôde au cœur de l’intimité secrète de chaque artiste, grâce, d’une part, à plusieurs analyses professionnelles et, d’autre part, à mon interprétation du contexte général de la composition via quelques commentaires de Sibelius lui-même.
Quels sont mes motifs ? Je me prépare en ce moment à vous livrer une explication tordue mais justifiée; en plus d’être, à présent, devenue capitale afin de ne pas trop passer pour un imbécile. C’est que la psychanalyse a un rapport plus ou moins direct avec le morceau traité dans cet article. Il s’agit de la Symphonie no. 4, op. 63 écrite par le formidable compositeur finlandais Jean Sibelius (1865-1957) au cours de l’année 1911; ce morceau est souvent considéré comme le plus énigmatique jamais écrit par l’artiste. A cette époque, après un démarrage tonitruant et controversé sur la scène des maladies psychologiques, les concepts du docteur Freud connaissaient une immense popularité, mais plus encore que la discipline proprement dite, c’est toute l’ambiance idéologique de cette période qui jouèrent un rôle déterminant pour l’écriture de cette œuvre singulière. Dans l’ombre du romantisme, cette nouvelle approche individualiste de l’être, prologue des excès que nous connaissons actuellement, allait, en effet, se matérialiser dans la société par une nécessité active d’expression de soi, par un besoin grandissant d’introspection. En art, c’est le courant expressionniste, dans lequel s’inscrit l’objet de notre étude, qui représente au mieux cette tendance. Dans ce cas de figure, commenter le morceau doit s’établir sur une recherche de ce que l’auteur a essayé de dire; il faut le comprendre et donc se poser la question suivante : quels sentiments a-t-il voulu transmettre par l’utilisation de son propre dialecte musical ? Pour y répondre, je me suis plongé dans le chaos indescriptible qui rôde au cœur de l’intimité secrète de chaque artiste, grâce, d’une part, à plusieurs analyses professionnelles et, d’autre part, à mon interprétation du contexte général de la composition via quelques commentaires de Sibelius lui-même.  Le début du 20e siècle fut évidemment marqué par la première guerre mondiale, une explosion sanglante conditionnée par les tensions du nationalisme exacerbé qui grouillait partout en Europe; un climat angoissé, radical, traduit en art par toutes sortes de nouvelles tendances orientées vers l’extrême et le conceptuel, parfois au mépris de la simplicité; une recherche d’idées qui se terminait bien souvent sur des productions sans âmes. Face à cette loi de la monumentalité, du neuf catégorique, le compositeur Jean Sibelius, se sentait probablement un peu victime, ébranlé, perdu au milieu d’une gigantesque cacophonie. Outre cet aspect purement artistique, la vie du compositeur avait été menacée au même moment par une tumeur à la gorge qui nécessita une chirurgie importante. C’est donc un homme tourmenté qui s’est mis au travail en Novembre 1910 ; il voulait se surpasser, combiner le modernisme avec une structure musicale strictement parfaite; être original en conservant les règles de son art. On peut donc en déduire que sa composition procède de plusieurs besoins personnels : s’exorciser de la maladie, vaincre ses doutes et faire une déclaration esthétique complexe, opposer une résistance au vacarme gesticulant qui l’envahissait. A la première, public et critiques furent incapables d’exprimer la moindre opinion sur cet ovni et la même réaction se répéta encore et encore à chaque performance. Son auteur était satisfait, ajoutant des années plus tard : “ce travail représente une part importante de ma personnalité”. De nos jours, la Symphonie no. 4 de Sibelius est considérée comme une réussite majeure et un point crucial dans l’histoire de la musique au 20e siècle. Tout commence par une plongée lugubre vers des profondeurs inconnues et plutôt inquiétantes, un violoncelle articule le thème principal du premier mouvement, une plainte étiolée reprise par l’ensemble des cordes. Peu à peu l’orchestre s’anime en plusieurs développements du motif avec une évidence remarquable sous la menace des cuivres; le morceau prend une tournure plus apaisée, une sorte de flottement indéterminé entre calme et tension. Le jeu sur les antonymes musicaux et les impressions opposées assure un effet d’incertitude qui est habillement employé à travers un assortiment d’harmonies majestueuses, comme une idylle naturaliste instable qui s’emballe pour mieux être subitement écrasée par une force ténébreuse; s’éteignant par après sur le motif altéré des quatre notes initiales. Le second mouvement prend une tournure beaucoup plus enjouée, s’ouvrant sur un dialogue naïf entre un hautbois et les cordes à l’unisson, cette section prend ensuite le contrôle du morceau, une mélodie innocente qui progressivement s’enfonce dans une tonalité plus grave, une noirceur subtile perturbant la joie apparente qui régnait jusque là. Encore une fois, Sibelius installe une opposition entre ombre et lumière; il précisa d’ailleurs à son beau fils, lors d’une conversation privée, que le thème du second mouvement était comme perverti, diabolisé par les échos sous-jacents de l’orchestre.
Le début du 20e siècle fut évidemment marqué par la première guerre mondiale, une explosion sanglante conditionnée par les tensions du nationalisme exacerbé qui grouillait partout en Europe; un climat angoissé, radical, traduit en art par toutes sortes de nouvelles tendances orientées vers l’extrême et le conceptuel, parfois au mépris de la simplicité; une recherche d’idées qui se terminait bien souvent sur des productions sans âmes. Face à cette loi de la monumentalité, du neuf catégorique, le compositeur Jean Sibelius, se sentait probablement un peu victime, ébranlé, perdu au milieu d’une gigantesque cacophonie. Outre cet aspect purement artistique, la vie du compositeur avait été menacée au même moment par une tumeur à la gorge qui nécessita une chirurgie importante. C’est donc un homme tourmenté qui s’est mis au travail en Novembre 1910 ; il voulait se surpasser, combiner le modernisme avec une structure musicale strictement parfaite; être original en conservant les règles de son art. On peut donc en déduire que sa composition procède de plusieurs besoins personnels : s’exorciser de la maladie, vaincre ses doutes et faire une déclaration esthétique complexe, opposer une résistance au vacarme gesticulant qui l’envahissait. A la première, public et critiques furent incapables d’exprimer la moindre opinion sur cet ovni et la même réaction se répéta encore et encore à chaque performance. Son auteur était satisfait, ajoutant des années plus tard : “ce travail représente une part importante de ma personnalité”. De nos jours, la Symphonie no. 4 de Sibelius est considérée comme une réussite majeure et un point crucial dans l’histoire de la musique au 20e siècle. Tout commence par une plongée lugubre vers des profondeurs inconnues et plutôt inquiétantes, un violoncelle articule le thème principal du premier mouvement, une plainte étiolée reprise par l’ensemble des cordes. Peu à peu l’orchestre s’anime en plusieurs développements du motif avec une évidence remarquable sous la menace des cuivres; le morceau prend une tournure plus apaisée, une sorte de flottement indéterminé entre calme et tension. Le jeu sur les antonymes musicaux et les impressions opposées assure un effet d’incertitude qui est habillement employé à travers un assortiment d’harmonies majestueuses, comme une idylle naturaliste instable qui s’emballe pour mieux être subitement écrasée par une force ténébreuse; s’éteignant par après sur le motif altéré des quatre notes initiales. Le second mouvement prend une tournure beaucoup plus enjouée, s’ouvrant sur un dialogue naïf entre un hautbois et les cordes à l’unisson, cette section prend ensuite le contrôle du morceau, une mélodie innocente qui progressivement s’enfonce dans une tonalité plus grave, une noirceur subtile perturbant la joie apparente qui régnait jusque là. Encore une fois, Sibelius installe une opposition entre ombre et lumière; il précisa d’ailleurs à son beau fils, lors d’une conversation privée, que le thème du second mouvement était comme perverti, diabolisé par les échos sous-jacents de l’orchestre.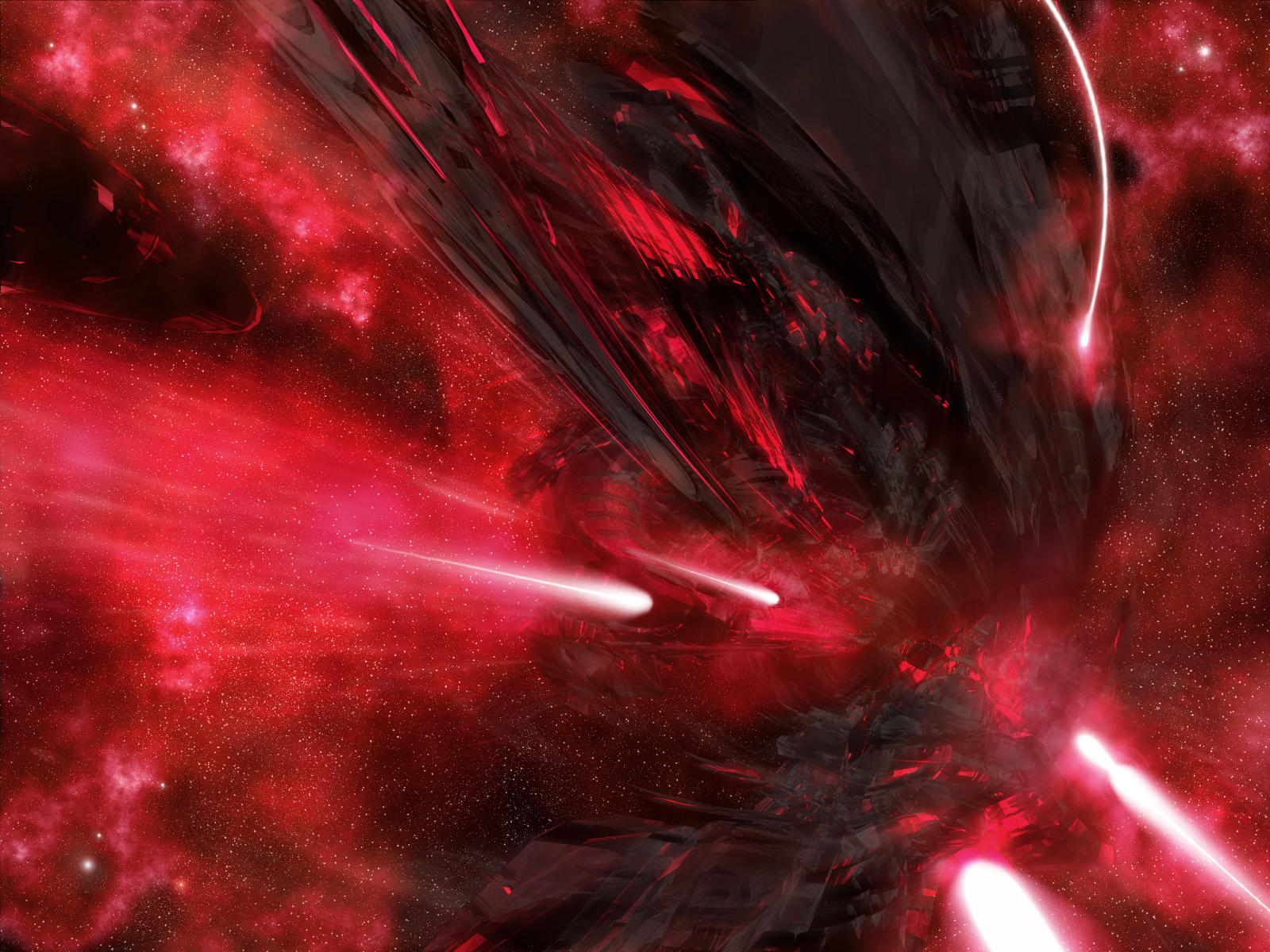 Pas le temps de s’acclimater car, déjà, l’artiste enchaîne avec la troisième partie du morceau; la plus lente et originale de l’ensemble. Un thème y est révélé progressivement, on dirait presque le résultat d’une improvisation brumeuse; un long chemin de mystères ondoyants qui soulève chaque groupe instrumental par des vagues incertaines; une émotion dramatique est distillée plus ouvertement au fur et à mesure sans qu’on puisse jamais en comprendre toute la signification; le tout s’achève en catimini avec pudeur et simplicité. Le dernier mouvement s’élance avec la même impression bucolique et enfantine exposée dans le second. Mais ici, le tempo augmente et, avec lui, les différentes sections de l’orchestre se répondent l’une à l’autre avec une intensité croissante. La couleur s’assombrit à nouveau. Un retour au paradis perdu de l’innocence oubliée est-il possible ? Il se maintient quelque peu dans la musique avant de se faire consumer par l’angoisse comme un cancer de l’âme qui gronde et, tordu, se contracte. Le final est une descente abattue, une route vers le néant. Les bois, les cordes, un souffle. Et puis, plus rien. C’est une œuvre grandiose par son économie de moyens, dépouillée, sans excès inutiles et cependant emprunte d’une sensibilité touchante. J’y trouve du sens, une texture ciselée emprunte de philosophie ; fatale, résignée mais indispensable. Alors que voulait-il dire ? Plusieurs mois après avoir fini son écriture, dans une conversation avec le peintre, écrivain et dramaturge August Strindberg (1849-1912), Sibelius évoqua la Symphonie no. 4 en une simple phrase : “qu’il est misérable d’être humain”; rien d’autre…
Pas le temps de s’acclimater car, déjà, l’artiste enchaîne avec la troisième partie du morceau; la plus lente et originale de l’ensemble. Un thème y est révélé progressivement, on dirait presque le résultat d’une improvisation brumeuse; un long chemin de mystères ondoyants qui soulève chaque groupe instrumental par des vagues incertaines; une émotion dramatique est distillée plus ouvertement au fur et à mesure sans qu’on puisse jamais en comprendre toute la signification; le tout s’achève en catimini avec pudeur et simplicité. Le dernier mouvement s’élance avec la même impression bucolique et enfantine exposée dans le second. Mais ici, le tempo augmente et, avec lui, les différentes sections de l’orchestre se répondent l’une à l’autre avec une intensité croissante. La couleur s’assombrit à nouveau. Un retour au paradis perdu de l’innocence oubliée est-il possible ? Il se maintient quelque peu dans la musique avant de se faire consumer par l’angoisse comme un cancer de l’âme qui gronde et, tordu, se contracte. Le final est une descente abattue, une route vers le néant. Les bois, les cordes, un souffle. Et puis, plus rien. C’est une œuvre grandiose par son économie de moyens, dépouillée, sans excès inutiles et cependant emprunte d’une sensibilité touchante. J’y trouve du sens, une texture ciselée emprunte de philosophie ; fatale, résignée mais indispensable. Alors que voulait-il dire ? Plusieurs mois après avoir fini son écriture, dans une conversation avec le peintre, écrivain et dramaturge August Strindberg (1849-1912), Sibelius évoqua la Symphonie no. 4 en une simple phrase : “qu’il est misérable d’être humain”; rien d’autre…
 Leur relation est incroyablement passionnante à étudier, von Meck était une grande admiratrice de son oeuvre; et par l’entremise d’un ami commun, le compositeur et pianiste Nikolai Rubinstein (1835-1881), elle entama une correspondance assidue avec Tchaikovsky et lui procura également une aide financière cruciale pour la liberté artistique de ce dernier; leur association dura, en tout, plus de 17 ans. Une bienfaitrice donc, une confidante, Pyotr Ilyitch avait trouvé quelqu’un à qui parler de son travail sans appréhension. Pourtant, malgré leur amitié sincère, très tôt dans leur correspondance, les deux parties décidèrent, d’un commun accord, de ne jamais se rencontrer; veuve, Nadezhda craignait pour sa réputation et n’osait pas se lancer dans une relation aussi intense*; Tchaikovsky, lui, en idéaliste, avait peur d’altérer leurs rapports en faisant le contraire. Si je m’attarde à ce point sur Madame von Meck, c’est en raison du rôle majeur qu’elle occupa dans l’écriture du morceau dont je traite aujourd’hui, le trio pour piano op. 50, composé à Rome entre Décembre 1881 et Avril 1882.
Leur relation est incroyablement passionnante à étudier, von Meck était une grande admiratrice de son oeuvre; et par l’entremise d’un ami commun, le compositeur et pianiste Nikolai Rubinstein (1835-1881), elle entama une correspondance assidue avec Tchaikovsky et lui procura également une aide financière cruciale pour la liberté artistique de ce dernier; leur association dura, en tout, plus de 17 ans. Une bienfaitrice donc, une confidante, Pyotr Ilyitch avait trouvé quelqu’un à qui parler de son travail sans appréhension. Pourtant, malgré leur amitié sincère, très tôt dans leur correspondance, les deux parties décidèrent, d’un commun accord, de ne jamais se rencontrer; veuve, Nadezhda craignait pour sa réputation et n’osait pas se lancer dans une relation aussi intense*; Tchaikovsky, lui, en idéaliste, avait peur d’altérer leurs rapports en faisant le contraire. Si je m’attarde à ce point sur Madame von Meck, c’est en raison du rôle majeur qu’elle occupa dans l’écriture du morceau dont je traite aujourd’hui, le trio pour piano op. 50, composé à Rome entre Décembre 1881 et Avril 1882.  Il est dédié “à la mémoire d’un grand artiste”, à savoir Nikolai Rubinstein, emporté par la tuberculose le 23 Mars 1881. Mais la véritable prémisse de ce morceau remonte encore à l’année précédente. Nadezhda écrivait alors à son protégé : “pourquoi n’écririez-vous pas un trio prochainement ?”. Dans sa réponse, le compositeur soutenait que, pour lui, la combinaison acoustique du violon, du piano et du violoncelle, sans autre accompagnement, était parfaitement incompatible, une véritable torture pour ses oreilles. En dépit de cette impression, l’idée d’un pareil travail s’accrocha à son esprit, et le conduisit progressivement à un volte-face caractéristique de sa nature contradictoire, comme le prouve une autre lettre adressée à von Meck qu’il rédigea le 27 Décembre 1881. Tchaikovsky explique : “Malgré mon antipathie pour une telle association d’instruments, je pense expérimenter ce style musical auquel je n’ai encore jamais touché. J’ai déjà écrit le début d’un trio. Si je compte le finir et s’il s’avérera, par la suite, être un succès, je n’en sais rien mais j’aimerais beaucoup conduire ce que j’ai commencé vers une conclusion heureuse… Je ne vous cacherai pas le grand effort de volonté qu’il m’a fallu pour poser mes idées dans cette forme nouvelle et inhabituelle. Mais je voudrais sincèrement dépasser toutes ces difficultés.”; il devint, peu à peu, complètement absorbé par cet opus, y travaillant sans relâche, avec passion, peaufinant les moindres détails pendant des mois avec l’aide d’autres musiciens et toujours encouragé par l’enthousiasme de Nadezhda von Meck. Une série de performances privées s’enchaînèrent par la suite, notamment lors d’une commémoration au Conservatoire de Moscou, un an après la mort de Rubinstein. Précisons encore, pour l’anecdote, que le morceau fut choisi en 1891 par l’ambassade russe à Washington D.C. (USA) pour une réception en l’honneur de Tchaikovsky qui visitait le continent. Aujourd’hui, ce trio est considéré comme une pièce maîtresse de la musique de chambre et fait l’objet d’incalculables performances extrêmement prestigieuses partout dans le monde. C’est une oeuvre résolument tragique, traditionnellement jouée d’une seule traite ou avec une courte pause, selon les spécifications de l’auteur, ce qui exige de l’endurance et une formidable virtuosité de la part des musiciens.
Il est dédié “à la mémoire d’un grand artiste”, à savoir Nikolai Rubinstein, emporté par la tuberculose le 23 Mars 1881. Mais la véritable prémisse de ce morceau remonte encore à l’année précédente. Nadezhda écrivait alors à son protégé : “pourquoi n’écririez-vous pas un trio prochainement ?”. Dans sa réponse, le compositeur soutenait que, pour lui, la combinaison acoustique du violon, du piano et du violoncelle, sans autre accompagnement, était parfaitement incompatible, une véritable torture pour ses oreilles. En dépit de cette impression, l’idée d’un pareil travail s’accrocha à son esprit, et le conduisit progressivement à un volte-face caractéristique de sa nature contradictoire, comme le prouve une autre lettre adressée à von Meck qu’il rédigea le 27 Décembre 1881. Tchaikovsky explique : “Malgré mon antipathie pour une telle association d’instruments, je pense expérimenter ce style musical auquel je n’ai encore jamais touché. J’ai déjà écrit le début d’un trio. Si je compte le finir et s’il s’avérera, par la suite, être un succès, je n’en sais rien mais j’aimerais beaucoup conduire ce que j’ai commencé vers une conclusion heureuse… Je ne vous cacherai pas le grand effort de volonté qu’il m’a fallu pour poser mes idées dans cette forme nouvelle et inhabituelle. Mais je voudrais sincèrement dépasser toutes ces difficultés.”; il devint, peu à peu, complètement absorbé par cet opus, y travaillant sans relâche, avec passion, peaufinant les moindres détails pendant des mois avec l’aide d’autres musiciens et toujours encouragé par l’enthousiasme de Nadezhda von Meck. Une série de performances privées s’enchaînèrent par la suite, notamment lors d’une commémoration au Conservatoire de Moscou, un an après la mort de Rubinstein. Précisons encore, pour l’anecdote, que le morceau fut choisi en 1891 par l’ambassade russe à Washington D.C. (USA) pour une réception en l’honneur de Tchaikovsky qui visitait le continent. Aujourd’hui, ce trio est considéré comme une pièce maîtresse de la musique de chambre et fait l’objet d’incalculables performances extrêmement prestigieuses partout dans le monde. C’est une oeuvre résolument tragique, traditionnellement jouée d’une seule traite ou avec une courte pause, selon les spécifications de l’auteur, ce qui exige de l’endurance et une formidable virtuosité de la part des musiciens.  Il n’y a que deux mouvement : le premier s’ouvre sur une mélodie affligée qui croît avec beaucoup de subtilité, de force, et subit toutes sortes de développements le long de vifs échanges entre le piano, le violon et le violoncelle; le second consiste en un thème décliné sur 12 variations originales et poignantes qui culminent avec un final déchirant et lugubre, celui-ci laisse les spectateurs les plus sensibles littéralement anéantis; dans la version live que j’ai choisie, on peut apprécier tout l’effet de ce final dans le silence estomaqué du public, prélude d’une ovation inévitable. Le morceau est pourvu d’une qualité presque symphonique tant le compositeur est parvenu à tirer le maximum des possibiltés sonores de chaque instrument. Il s’étire, se cabre, se métamorphose à l’infini, une transposition musicale de la détresse et de ses nombreux visages. Entre la peine face à l’absence, les souvenirs attendris, la rage envers la fatalité, on s’égare d’un ressenti à l’autre, on est tantôt dévasté, tantôt sous le charme, c’est une cascade de surprises. Les harmonies sont divines, elle offrent une saveur supplémentaire à ce déballage vibrant de sons merveilleux. Ce trio frénétique se distingue enfin par son ambiance intime couplée, par je ne sais quel miracle, à une exploration cosmique de l’imaginaire. Délicat, inspiré, émouvant, les adjectifs s’accumulent et se mélangent pour décrire cette danse féérique, une preuve magistrale parmi d’autres du génie créatif d’un homme qui fut hanté toute sa vie par le doute…
Il n’y a que deux mouvement : le premier s’ouvre sur une mélodie affligée qui croît avec beaucoup de subtilité, de force, et subit toutes sortes de développements le long de vifs échanges entre le piano, le violon et le violoncelle; le second consiste en un thème décliné sur 12 variations originales et poignantes qui culminent avec un final déchirant et lugubre, celui-ci laisse les spectateurs les plus sensibles littéralement anéantis; dans la version live que j’ai choisie, on peut apprécier tout l’effet de ce final dans le silence estomaqué du public, prélude d’une ovation inévitable. Le morceau est pourvu d’une qualité presque symphonique tant le compositeur est parvenu à tirer le maximum des possibiltés sonores de chaque instrument. Il s’étire, se cabre, se métamorphose à l’infini, une transposition musicale de la détresse et de ses nombreux visages. Entre la peine face à l’absence, les souvenirs attendris, la rage envers la fatalité, on s’égare d’un ressenti à l’autre, on est tantôt dévasté, tantôt sous le charme, c’est une cascade de surprises. Les harmonies sont divines, elle offrent une saveur supplémentaire à ce déballage vibrant de sons merveilleux. Ce trio frénétique se distingue enfin par son ambiance intime couplée, par je ne sais quel miracle, à une exploration cosmique de l’imaginaire. Délicat, inspiré, émouvant, les adjectifs s’accumulent et se mélangent pour décrire cette danse féérique, une preuve magistrale parmi d’autres du génie créatif d’un homme qui fut hanté toute sa vie par le doute…




